American Witches
– J’ai froid.
– Ben t’as du mérite, il fait 23° dehors. Si tu veux foutre les jetons aux gens pour Halloween, déguise-toi en réchauffement climatique, d’ailleurs, ça sera plus efficace que ta tentative de l’an dernier. Casper, sérieusement ?
– C’était une très bonne idée. Et originale, on était que 108 dans la rue.
– Tu n’as pas arrêté de te prendre les pieds dans le drap et de te cogner aux lampadaires. « HooooouhouOUAILLEpoteaudemerde », ça ne fait pas très peur, tu sais.
– Aucun souvenir et de toute façon j’ai froid et puis j’ai peur. Remets une bûche dans l’âtre, Sam, veux-tu bien ? Seule une bonne flambée jettera un peu de lumière et de chaleur au sein de ce foyer
– « Une bûche dans l’ât… ? » Je sais que ce site est réputé pour son excellente tenue littéraire, mais tu es vraiment forcé de parler comme dans La petite maison dans la prairie ?

– Je te dis que je me gèle les roupett… les os. Tu vas lui foutre le feu, oui, à cette foutue bûche ?
– D’accord, d’accord, on ne peut rien contre les manifestations psychosomatiques. Et je peux savoir pourquoi tu as froid à ce point ?
– Je viens de lire une histoire glaçante. Une de ces histoires que tout le monde connaît sans la connaître.
– La Mary Celeste ? Tu as déjà fait le coup la semaine dernière.
– Non, je crois que j’ai fait le tour des vaisseaux hantés pour un moment. On est davantage dans le registre sorcellerie.
– Ce qui nous amène vers l’Europe de l’époque moderne, donc.
– Pas du tout, ça nous emmène au beau milieu de la Nouvelle-Angleterre, pas bien loin de Boston et au cœur du Machassu, du Sachuma, du Machu…
– Tu fais un AVC ?
– DU MAS SA CHUS SETTS bon dieu j’y suis arrivé. Souffle encore un peu sur les braises, Sam, tu seras gentil, je n’ai pas encore tout à fait assez chaud au niveau de mes petits petons.
– Tu ne me prendrais pas un peu pour le majordome, dis-moi ?
– C’est pour l’ambiance parce que tu sais ce qui va avec une bonne histoire de sorcières ?
– Non ?
– Une bonne flambée.
– C’est malin.
– Blottis-toi près du feu, mon cher petit. On part pour l’extrême-nord des États-Unis en 1691.

– Je prends un crucifix ?
– Un pull, plutôt, ça caille. Imagine une enfilade de petites maisons de bois blotties les unes contre les autres pour se protéger de tout ce qui peut menacer le petit village de Shalom. Le froid. Les bêtes. La maladie. Quelque chose d’autre, de sauvage et d’ancien, va savoir. On parle beaucoup du Windigo, dans le secteur.
– OK, j’ai déjà un peu peur.
– Eh ben tu peux oublier, parce que Shalom, le nom d’origine qui a petit à petit glissé ver Salem, ne ressemble pas du tout ça. Ou plutôt si, mais seulement en partie. En réalité, il y a deux Salem : le bourg portuaire d’un côté, assez prospère pour concurrencer Boston à une époque où on parle encore de petites villes de pionniers installés là depuis trois générations à peine, et le village de l’autre, un peu à l’écart de la côte. C’est là que vivent les familles paysannes et le moins qu’on puisse dire, c’est que la relation entre les deux Salem tangue sérieusement. Le Salem des villes n’a pas les mêmes idées, les mêmes priorités et les mêmes convictions que le Salem des champs, pour faire court. Et la division pointe même son nez au cœur de chaque communauté. Chez les villageois, des voix s’élèvent pour que le Salem des champs envoie paître la « ville » et prenne son indépendance, avec ses règles de vie commune, son propre conseil, sa liberté de décision.
– Je ne dis pas que les engueulades villageoises n’ont pas leur intérêt, Maupassant, mais pourquoi tu me racontes tout ça ?
– Parce que c’est déterminant pour la suite. En 1691, ça fait déjà deux ans que les villageois ont obtenu du bourg le droit de créer leur propre paroisse, donc de disposer de leur propre pasteur : Samuel Parris, un ancien commerçant qui a davantage le sens des réalités matérielles que celui du salut de l’âme immortelle de ses paroissiens.
– Ah bon ?
– Oui, il cherche à récupérer la propriété du presbytère qu’il occupe avec sa famille, ce qui a tendance à tendre légèrement une ambiance déjà pas fameuse. En octobre 1691, une partie du village décide tout bonnement d’arrêter de contribuer à son salaire.
– Bonne ambiance.
– Oui, le contexte n’est pas glorieux. L’hiver qui s’annonce est rude, pas seulement sur le plan des températures. Le ciel est plombé, la neige est froide comme l’enfer et de drôles de choses commencent à se produire.
– Ah.
– Prends Abigail Williams et Betty Parris, par exemple. Deux gentilles petites de 11 et 9 ans. La première est la nièce du révérend Parris, l’autre sa fille. Et voilà que les deux gamines se mettent à se comporter bizarrement. Elles se cachent, marmonnent des mots inconnus, hurlent à la lune et marchent avec de grands gestes incontrôlés. Elles montrent des hématomes aux bras, aux jambes. Elles n’en sont pas encore à décrire les pratiques sexuelles des mamans aux Enfers comme dans L’Exorciste, mais pas loin.
– Oh merde.
– Comme tu dis. Non seulement ça fout la pétoche, mais d’autres enfants sont touchés. Ça vire même à l’épidémie. En quelques jours, une dizaine de mômes se mettent à se comporter de la même manière. Une autre petite, notamment, inquiète tout le village : Ann Putnam, une amie d’Abigail et de Betty. Horrifiés, les villageois observent les filles convulser, se recroqueviller sous des chaises et hurler des inepties. Et comme les médecins consultés n’y comprennent que couic, il ne reste guère qu’une explication possible, pour beaucoup d’honnêtes gens de Salem.
– La possession démoniaque ?
– Voilà. Quelqu’un a ensorcelé les gamines. Mais qui ? Qui a invité le diable à sa table, au cœur de Salem ?
– Je te le demande.
– Ben là, on le demande surtout aux filles et sans douceur particulière, crois-moi. On leur met une pression pas possible sur les petites. Dis-nous, Abigail, ce ne serait pas lui, avec son air bizarre et son œil pas droit ? Dis-nous, Betty, ce ne serait pas elle, avec son drôle de regard ? Et celle-ci, qui vit à l’écart et qui mendie toute la sainte journée pendant que les honnêtes gens travaillent, eux, elle ne serait pas un peu suspecte ? Déjà qu’on l’a vu près des vaches qui sont tombées malades l’autre saison, promis craché. Etc., etc.
– Les pauvres gosses…
– … paraissent enfin craquer. Brutalisées, Abigail et Betty lâchent des noms et le 1er mars 1692, trois femmes sont officiellement inculpées de sorcellerie : Sarah Osborne, une vieille femme qui a le malheur de s’être remariée en privant ses enfants du premier lit de l’héritage, Sarah Good, une mendiante qui a le malheur de ne pas fréquenter l’église, et l’esclave noire du pasteur Parris, Tituba, qui a le malheur de pratiquer le vaudou – la religion des siens, quoi.
– La paranoïa retombe ?
– Tu parles. En dépit de ces trois arrestations les gamines continuent de montrer les mêmes signes inquiétants. Dans un village malade de terreur, tout devient signe. Chacun guette chez l’autre un signe de possession, la marque du démon. Une période de dénonciation de masse commence, une chasse aux sorcières au sens propre et évidemment, tu peux compter sur l’effet d’aubaine chez certains braves gens. Sous prétexte de chasser le diable, on en profite pour régler quelques comptes. Satan est commode pour solder de sombres histoires de vols entre voisins, de dettes non réglées, d’insultes mal digérées, de champs mal délimités… Toutes les vieilles haines recuites ressortent comme une marée d’huile noire qui pourrit absolument tout. Des voisins accusent leurs voisins. Des parents dénoncent leurs enfants. Des enfants balancent leurs parents. Certains pointent du doigt les notables du la Salem « riche », le bourg portuaire. À elle seule, Abigail accuse… 57 personnes.
– Ah oui, quand même.
– Oh ben une fois lancée, hein. En prison, les suspects s’entassent pendant des mois. On en compte jusqu’à 300. Mais toujours pas de procès, faute de tribunal compétent – rappelle-toi que le port et le village de Salem s’engueulent pour savoir qui contrôle quoi, comment et de quel droit.
– Sympa pour les accusés qui poireautent en préventive sous prétexte que des gamines brutalisées ont lâché leur nom.
– Bonne nouvelle : en mai 1692 arrive une sorte de cour itinérante.
– Une pardon ?
– C’est l’Amérique du temps des pionniers, Sam. Des colonies, pas les États-Unis. Il n’y a pas de système judiciaire réellement organisé et structuré et le droit qui s’applique a des frontières quelque peu mouvantes. En l’occurrence, la Loi est incarnée par un certain William Stoughton, qui débarque à Salem au printemps 1692.
– C’est mieux que rien, j’imagine.
– Pas trop, non, dans la mesure où William Stoughton est un allumé de premièr… Pardon, on le refait en plus neutre : un puritain qui n’a aucune formation juridique mais vit par et pour la Bible, ou plutôt pour ce qu’il a décidé d’y lire. Sa seule légitimité vient du fait qu’il est expédié à Salem par le gouverneur royal William Phips avec six autres « magistrats » à peu près aussi bien formés que lui pour y tenir une « Court of Oyer and Terminer », une Cour pour « entendre et déterminer ».
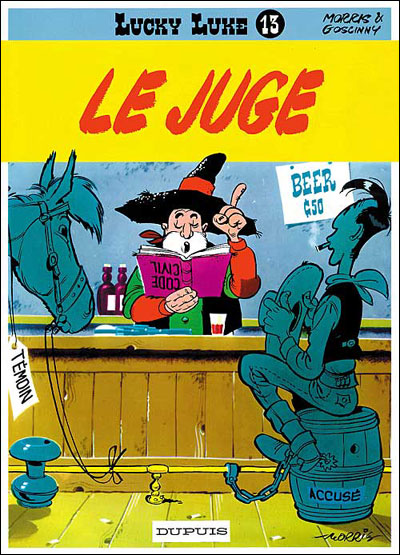
– Et alors, ils entendent et ils déterminent ?
– Oh ben ça pour entendre, ils entendent. Et ils entendent même un sacré paquet de conneries à une date ou une des premières accusées est déjà morte en taule. Poussés à bout, épuisés par des mois de détention, les accusés racontent n’importe quoi. Tituba, l’esclave noire accusée de pratiques vaudous, avoue avoir confectionné un gâteau ensorcelé pour identifier l’homme qui aurait envoûté sa jeune maîtresse.
– Ben c’est- plutôt positif, ça du coup ?
– Magie blanche mais magie quand même. Et puis elle raconte bien d’autres choses, Tituba : des histoires de chiens noirs, de chats rouges et d’oiseaux jaunes, la rencontre aussi d’un homme aux cheveux blancs qui lui aurait ordonné de signer le livre du Diable. Elle répète aussi les accusation des petites et pointe nommément du doigt d’autres accusés. Surtout des femmes mais aussi plusieurs hommes.
– Mais enfin on l’écoute ? Ils font quoi, les avocats de la défense ?
– Les pardon ?
– Ah.
– Voilà. Question droits de la défense, c’est du grand n’importe quoi – même pour l’époque. Les accusés n’ont pas d’avocats. Les juges sont aussi les enquêteurs. Les témoins parlent à huis-clos, et n’ont pas le droit d’aller à la barre, des fois qu’ils y jettent un sortilège. Aucune contradiction, aucune défense possible : tout suspect est perdu d’avance.
– Mais quel enfer.
– Attention avec ce mot, Sam. C’est le genre de termes qu’il ne vaut mieux pas prononcer à Salem cette année-là. Au cours de l’été 1692, absolument TOUS les accusés sont déclarés coupables. Et on parle d’une centaine de personnes, à ce stade.
– Hein ?
– Comme je te le dis. Aucun acquittement, et uniquement des condamnations à mort. Tout au long du procès, la seule manière d’échapper à la mort consiste à plaider coupable et à donner des noms pour espérer voir la peine de mort commuée en détention à vie. Vingt personnes, 14 femmes et 6 hommes, sont petit à petit exécutées à l’été 1692.
– Bon dieu. Et la peine de mort en question c’est….
– La corde. Enfin presque tout le temps : un homme de 80 ans, Giles Corey, subit un autre châtiment. Un traitement spécial, quoi.

– Pourquoi ?
– On pourrait dire que Corey était un vieux fermier tenace qui n’avait pas la moindre intention de vivre ses dernières semaines sur terre en se couchant devant une palanquée d’abrutis obscurantistes, mais ce serait un poil héroïsé. En tout cas, il était certain d’un truc : il n’avait rien à se reprocher et il n’a pas jugé utile de prononcer le moindre mot devant le tribunal. Qui s’est vexé, dis donc.
– Et qui lui a infligé quoi ?
– La « peine forte et dure ». On a rivé Giles Corey au sol et on a placé des pierres dessus.
– On l’a lapidé ?
– Oh non. On a juste accumulé des pierres dessus, pour que le poids finisse par l’écraser. Il a mis trois jours à mourir.
– Mais que je MAIS ENFIN.
– Eh oui. Vingt pendaisons, un peine forte et dure : tout ça nous fait vingt-et-une exécutions en tout, donc, et même vingt-deux en comptant un chien.
– Ils ont exécuté un chien ?
– Un animal du démon, Sam.
– Mais enfin c’est n’importe quoi.
– N’est-ce-pas.
– Tout le monde sait que c’est le chat.
– HEY.
– Je veux bien que tu hurles au scandale, mais je te signale que la Honte de son Espèce est en train de pisser sur le vomi qu’il a lâché dans tes pantoufles pour recouvrir son dernier caca.
– Je… Rien à voir. Bref : la procédure est tellement lunaire qu’elle finit par provoquer l’intervention décisive d’un théologien de Boston, le très influent pasteur Mather, qui publie un essai intitulé Cases of Conscience Concerning Evil Spirits (Cas de conscience concernant les esprits maléfiques) où il explique en substance qu’il va peut-être falloir arrêter de faire n’importe quoi et de tuer des gens pour rien.
– Et ça suffit ?
– Disons que ça pousse le gouverneur royal à bouger son gros cul pour freiner les ardeurs du dangereux malade homicide qu’il avait désigné comme juge. Et encore, il a fallu qu’on l’aide un peu, William Phips.
– C’est-à-dire ?
– C’est-à-dire que les jeunes filles possédées ont fini par désigner sa propre femme. Bizarrement, c’est là qu’il s’est dit que ça allait peut-être un peu loin.
– C’est d’un humour noir assez abominable.
– N’est-ce pas. Bref : Phips suspend le tribunal spécial et le remplace par une cour supérieure où on arrête enfin de prendre en compte les « preuves spectrales » ne sont pas entendues. Trois des cinquante-six accusés sont condamnés tout de même, mais William Phips les graciera finalement, tout en graciant les cinq autres personnes qui attendaient d’être pendues, des femmes enceintes pour la plupart.
– J’ai une question.
– M’aurait étonné.
– Il s’est passé QUOI putain ? Pourquoi elles ont commencé à vriller, les petites ?
– Alors ça… On a tout essayé. Les historiens ont tout tenté. L’explication psychologique d’abord : l’isolement, le froid, la sensation de lutter seuls dans un monde hostile, et j’en passe, avec une psychose collective à la clé. L’explication médicale ensuite : en a pensé à une intoxication aux grains de seigle, ce qu’on connaît en Europe comme le Mal des Ardents ou le feu Saint-Antoine. Elle peut provoquer certains spasmes, des hallucinations et la sympathique impression que des bêtes vous courent sous la peau. On a aussi pensé que les mômes avaient simplement voulu éviter quelques corvées puis que dépassées, elles n’avaient jamais osé avouer.
– On ne saura jamais, c’est ça ?
– Probablement pas.
– Tu m’énerves.
– C’est ma raison de vivre.
2 réflexions sur « American Witches »
Une vidéo qui a exploré certaines pistes..
https://youtu.be/ZepvkHpGfNI
Une (autre) incroyable et fabuleuse chanson sur le MAS SA CHU SETT
https://youtu.be/JvUMV1N7eGM