Quand l’éthique tique : sujets de seconde zone
Premier épisode ici.
– Bon, avant d’aller plus loin, reconnaissons une chose : les exemples que nous avons vus étaient peut-être, voire certainement, contestables dans les méthodes suivies, mais le but était quand même toujours globalement de faire progresser la science médicale. On ne saurait contester la vaccination ou le développement de la chirurgie gynécologique.
– Je te suis.
– Je le précise parce qu’au 20ème siècle nous avons malheureusement connus des expérimentations qui non seulement étaient abominables dans leur organisation et conduite, mais dont l’intérêt scientifique et la portée médicale étaient au mieux très discutables. Je veux dire par là que l’objet premier était largement de laisser des tordus patentés donner libre cours à leurs penchants malades.
– Carrément ?!
– Oui, carrément. Je parle des expériences menées par des médecins nazis ou japonais pendant la deuxième guerre.
– Uh, effectivement.

– On ne va pas rentrer dans le détail, on y reviendra peut-être à l’occasion, mais il est entendu qu’en l’occurrence on parle bien plus de torture déguisée en étude, ou à la limite d’étude de la torture, que de science.
– Ca me va.
– Cet épisode ignoble a conduit en 1947 à l’adoption du Code de Nuremberg. Puisque manifestement le premier principe d’Hippocrate, à savoir ne pas nuire, ne suffisait pas, ce code pose que les sujets d’une expérimentation doivent être consentants, peuvent arrêter quand ils veulent, et que les traitements doivent être délivrés par des professionnels. Par ailleurs, l’expérience doit apporter de réels bénéfices pour la société, qui ne sauraient être obtenus autrement.
– Dommage qu’il soit utile de le préciser, mais comme ça c’est fait.
– Effectivement, sauf que le message n’est pas toujours bien passé. Avant l’adoption du Code, il y avait, ailleurs que sous le Reich ou l’Empire, des expériences limites, et on en a encore menées après.
– Mais enfin, comment…
– James Sims considéraient que les Noirs étaient des sujets d’expérimentation dont il pouvait disposer comme il voulait, et qui supportaient mieux la douleur. Leo Stanley voyaient ses prisonniers comme des individus ratés, sur lesquels il était légitime à intervenir pour les réformer. Autrement dit, beaucoup de chercheurs pensaient manifestement qu’on pouvait inoculer des maladies et mener des expériences sur des individus qui n’avaient pas pleinement les mêmes droits que les autres. Un raisonnement sur le fond pas si éloigné de celui des Nazis. Le sacrifice de personnes moins importantes, pour le bien du plus grand nombre.
– J’ai peur de poser la question, mais en l’occurrence ce sont qui ces individus qui n’ont pas tout à fait les mêmes droits que les autres ?
– Sans surprise, on peut distinguer plusieurs catégories, qui ne sont pas mutuellement exclusives : les prisonniers, les Noirs, les étrangers, et les malades mentaux.
– On est tous égaux, mais certains plus que les autres.
– Exactement. En 1915, le docteur Joseph Goldberger recrute ainsi des prisonniers du Mississippi pour une étude qui vise à démontrer que la pellagre trouvait son origine dans une carence alimentaire, plutôt qu’une infection. Il atteindra son but, et c’est notamment grâce à lui que cette maladie n’est aujourd’hui plus guère connue. Là encore, le bénéfice médical n’est pas contestable. Cependant si les prisonniers participants étaient volontaires, c’était contre la promesse de remise de peine. C’est un poil limite.
– Quel prisonnier ne voudrait pas sortir plus tôt.
– Voilà.
– Pour illustrer une autre catégorie de population test, on peut se référer à une expérience menée en 1942, par Jonas Salk.
– Attends, Salk c’est un héros.
– Je suis bien d’accord. Non seulement on lui doit le vaccin contre la polio en 1953, mais en plus il a la noblesse de ne pas le breveter pour qu’il soit plus accessible à tous, accélérant ainsi le traitement dans le monde. Il n’empêche qu’en 1942 il recrute les patients d’un asile psychiatrique pour un essai de vaccin contre la grippe. On parle là d’une étude en deux temps : administration du vaccin, puis exposition au virus. D’accord, c’est la grippe, ce n’est que la grippe…

– C’est bon, ça ira, merci.
Mais on peut s’interroger sur la réalité du recueil du consentement de patients internés en asile. Il n’est pas certain qu’ils aient bien tous compris ce qu’on leur faisait.
– On peut l’imaginer.
– Dans les années 40 toujours, d’autres patients d’hôpitaux psychiatriques ont été exposés à l’hépatite, dans le Connecticut, tandis que les pensionnaires d’une maison de correction de New York sont recrutés dans une étude sur la propagation d’un parasite gastrique, accessoirement mortel. Ils doivent…euh…boire des suspensions de matière fécales non filtrées, et l’étude ne précise pas s’il y a eu compensation.

– Il aurait fallu me payer très très cher.
– On abordera ton dossier de maison de correction une autre fois. Plus ou moins cher que pour cette étude, sur des prisonniers cette fois, à propos des modes de transmission de la blennorragie, pour laquelle certains l’ont reçue par injection directe dans le pénis ?
– Je reviens…
– Toujours est-il qu’il y a un doute sur le fait qu’ils étaient bien tous volontaires.
– Avant ou après qu’on leur ait expliqué le protocole ?
– Justement, va savoir. Tiens, encore deux pour la route. En 1963, le docteur Chester Southam injecte des cellules cancéreuses à des patients âgés et infirmes d’un hôpital de Brooklyn. Ils sont ainsi une vingtaine à recevoir des cellules HeLa, ça doit te rappeler quelque chose.
– En effet.
– L’idée est d’étudier leurs réactions. Le petit truc qui chiffonne un rien, c’est que le directeur de l’hôpital considère qu’il n’est pas nécessaire d’informer les patients. Parce que les injections sont inoffensives.
– Nan, sérieux ?
– C’est exactement la réaction d’un des administrateurs de l’hôpital, qui conteste la décision et déclenche une enquête publique. Elle conduit l’établissement à admettre que oui, bon, d’accord, il faut leur consentement. Le docteur Southam est suspendu pendant un an, mais finira quand même président de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer.

Dans le même temps, et pas loin, tu as les élèves d’une école pour enfants attardés de Staten Island à qui on inocule l’hépatite.
– Comme si y’avait pas déjà suffisamment de maladies qui traînent dans les écoles.
– C’est vrai. Cela dit, tout ça c’est de la petite bière, avec deux-trois trucs bizarres qui flottent dedans. Le vrai gros scandale de l’époque, il va être découvert quelques années plus tard, et totalement par chance.
– Je t’écoute.
– En 1966, un médecin de San Francisco reçoit un nouveau patient. L’homme est assez âgé, et présente une forme non déterminée de démence. Après examen, notre praticien identifie une syphilis. Elle est assez avancée, puisqu’on en est au stade neurologique, mais reste totalement traitable. Il prescrit donc un traitement antibiotique, et le patient va pouvoir se soigner. Fin de l’histoire.
– Je ne vais pas te cacher que je reste un peu sur ma faim.
– Je comprends. Ok, on rajoute un épisode. Peu de temps plus tard, le médecin en question reçoit un coup de fil du Center for Disease Control d’Atlanta. Le Centre de Contrôle des Maladies.
– Haaa, c’est là-bas qu’ils pilotent les maladies…
– Mais non benêt, c’est la principale agence fédérale de santé publique. Dans un film de zombies sur deux, c’est l’endroit où il faut aller pour avoir des réponses mais en fait se rendre compte que tout le monde s’est fait avoir.
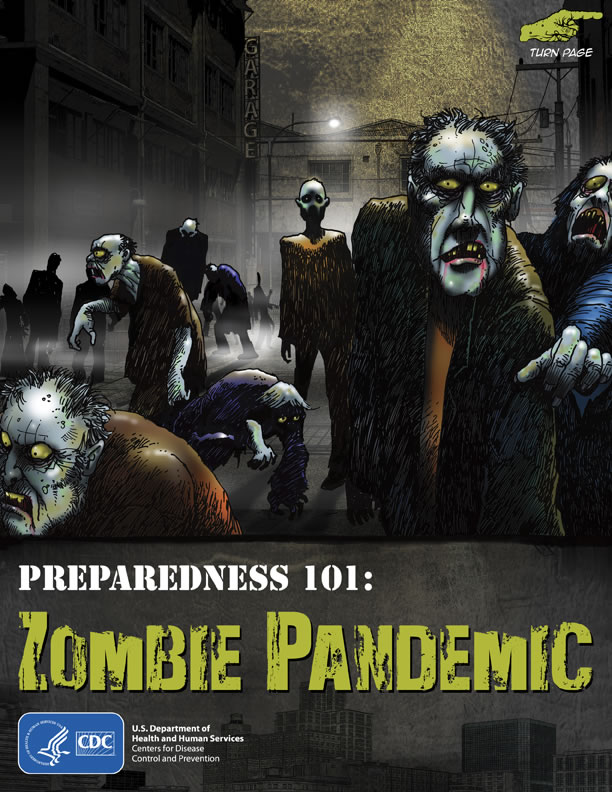
Il n’est cependant pas question de zombies en l’occurrence : le médecin se fait vertement engueuler pour avoir traité son patient.
– Non mais c’est vrai ça, quelle idée ! Non, sérieusement, pourquoi il se fait remonter les bretelles ?
– Exactement pour cette raison : il a soigné son patient, perturbant ainsi une étude en cours.
– Mais euh…attends, tu m’as dit que le patient s’était pointé sans savoir exactement de quoi il souffrait ?
– En effet.
– C’est quoi le genre d’étude dans laquelle des sujets ne savent pas qu’ils ont une maladie pourtant connue, et qu’on interdit aux médecins de soigner, exactement ?
– Judicieuse question. Cependant le toubib en question est remarquablement discipliné, et il fait précisément ce qu’on lui demande, à savoir qu’il la boucle et garde tout ça pour lui. Raison pour laquelle je serais bien infichu de te donner son nom, il est resté anonyme.
– Mais alors…
– Cependant un peu après, un agent du service de santé publique fédéral (US Public Health Service), Peter Buxton, prend son repas à la cantine. Et il entend à la table d’à côté un collègue raconter cet épisode, pour se faire mousser auprès d’infirmières.

Buxton est pour le moins intrigué. Il écrit au service fédéral des maladies vénériennes, mais ne reçoit pas de réponse. Il finit donc par avertir Jean Heller, d’Associated Press, qui sort l’affaire en 1972 dans le New York Times. Le monde découvre alors l’expérience de Tuskegee.
– Qu’est-ce que c’est ?
– Tuskegee, c’est une bourgade du comté de Macon.
– Tu m’étonnes, je ne connais pas cette appellation.
– Le comté de Macon, dans l’Alabama. La ville est surtout connue pour avoir vu grandir Rosa Parks. Ce qui te donne une idée de la démographie locale. En 1932, le Public Health Service décide d’y mener une expérience : the Tuskegee study on untreated syphilis in the negro male. Si les termes choisis sont à l’époque moins de nature à choquer qu’aujourd’hui, le mot important est ici plutôt untreated. Il s’agit d‘étudier les effets de la syphilis sur la durée, en l’absence de traitement au sein d’une population donnée, en l’occurrence les Noirs de Tuskegee. Une campagne de recrutement est alors menée, avec des prospectus promettant aux personnes de couleur un traitement contre le « mauvais sang ». Ce n’est pas le fait d’avoir des soucis, c’est juste un terme générique et particulièrement peu précis pour attirer les personnes susceptibles d’avoir la syphilis, mais sans leur dire. Le message est le suivant :
« Test sanguin gratuit, traitement gratuit, fournis par le département de la santé du Comté et des médecins gouvernementaux. Vous pouvez vous sentir bien tout en ayant le mauvais sang, venez et amenez toute votre famille »
Tu auras remarqué que l’annonce mentionne un traitement gratuit.
– J’ai remarqué.
– Cette campagne porte ses fruits, et attire des volontaires. Ce sont ainsi 600 hommes noirs qui sont recrutés pour l’étude. Soit 399 qui sont diagnostiqués comme syphilitiques, et 201 qui ne le sont pas et qui servent de groupe contrôle. On leur promet des tests et soins gratuits, dans le temps, des repas, et éventuellement la prise en charge des frais d’obsèques.

– ET AUSSI DES REPAS GRATUITS.
Faut reconnaître que les promesses sont tenues sur la plupart des points. Il y a effectivement des tests et un suivi dans la durée. Mais il n’y a aucune information sur la nature réelle de l’étude et de la maladie étudiée, donc pas de consentement éclairé, et pas de soins non plus.
– Ben non, puisque l’idée c’est de suivre les effets sur une population non traitée.
– Précisément. Alors il convient de préciser une chose : quand l’étude est lancée en 1932, il y a un traitement contre la syphilis. Je veux dire, un traitement qui n’est pas pire que le mal comme le mercure. Il s’agit du salvarsan, dont la découverte part de travaux sur les teintures, comme on l’a déjà raconté. Il présente cependant des effets secondaires assez lourds, notamment des nausées et vomissements. Si on voulait vraiment jouer les avocats du diable zélés, on pourrait donc à la limite arguer qu’à l’époque ne pas traiter peut éventuellement se justifier. Mais le fait de ne rien dire aux sujets sur la nature de leur maladie, y’a pas moyen de justifier. D’autant moins que…
– Quoi encore ?
– Ben la syphilis c’est une maladie sexuellement transmissible.
– Ooooh.
– A partir du moment où tu laisses 400 hommes mener leur vie sans savoir qu’ils sont porteurs, tu exposes au final une population plus large.
– Mon Dieu.
– Par ailleurs, quand le traitement à la pénicilline est mis au point quelques années plus tard, le CDC met en place des centres de traitement rapide à travers le pays, mais ça ne change rien pour les cobayes de Tuskegee. Il s’agit de suivre dans le temps les effets de la syphilis non traitée, donc on continue à ne rien leur dire et à ne pas les soigner. Initialement prévu pour 6 mois, l’expérience est étendue sur 40 ans.
– 40 ans ?!
– Le CDC décide de suivre la cohorte jusqu’à la mort. Et il ne s’agit pas d’un refus passif de leur fournir un médicament efficace et accessible, on les empêche activement d’être traités. Des infirmières recrutées dans l’étude accompagnaient des patients chez les médecins pour s’assurer qu’ils ne recevaient aucun médicament, et on a vu ce qui arrivait si un toubib s’avisait de diagnostiquer et soigner la maladie. Quand Buxton permet de révéler l’affaire en 1972, 28 participants à l’étude sont directement morts de la syphilis, et 100 autres de complications liées. Auxquels on peut ajouter 40 femmes contaminées, ainsi que 19 enfants qui sont nés avec la maladie.
– Dis-moi au moins que ça fait scandale.
– Oui. Il y a eu une commission d’enquête parlementaire, et un an plus tard un groupe de cobayes intente une action de groupe en justice. Ils obtiennent un arrangement avec 10 millions de dollars à la clé, plus des (vrais) soins médicaux à vie. En 1973, le Congrès adopte le National Research Act, pour éviter que ce genre de choses se reproduise.
– Bonne chose de faite.
– T’emballe pas, le boulot n’est pas fini. En 1974, on apprend que la prison de Holmesburg, à Philadelphie, organise depuis 1959 des tests avec plusieurs agences fédérales et une trentaine de sociétés privées. Il s’agit d’essayer sur des prisonniers des trucs divers, qui vont des produits dermatologiques aux substances radioactives, cancérigènes, ou hallucinatoires.

Les responsables de ces études soulignent que les risques étaient minimaux, et que les détenus pouvaient ainsi gagner jusqu’à 1 500 dollars, ce qui constituait une belle somme. Cependant dans le cadre des auditions parlementaires qui suivent la révélation de l’expérience de Tuskegee, des industriels pharmaceutiques reconnaissent qu’ils utilisent des prisonniers parce qu’ils reviennent moins chers que des singes.

Par conséquent, en 1978, une loi fédérale encadre les tests sur les prisonniers. Ils sont autorisés si les risques « ne sont pas plus que minimaux ».
– Quand on dit que la prison c’est le club Med.
– On parlera de tes histoires de colonie de vacances et de maladie vénériennes une autre fois.
– Oui bon ben au moins maintenant le cadre réglementaire est complet. Hein, il est complet maintenant ?
– Grand naïf. Si on n’a plus de populations pauvres, mal éduquées, et moins bien protégées que les autres à la maison, on fait quoi ?
– On…mène des expériences cliniques dans de bonnes conditions ?
– Ou on les organise à l’étranger.
2 réflexions sur « Quand l’éthique tique : sujets de seconde zone »